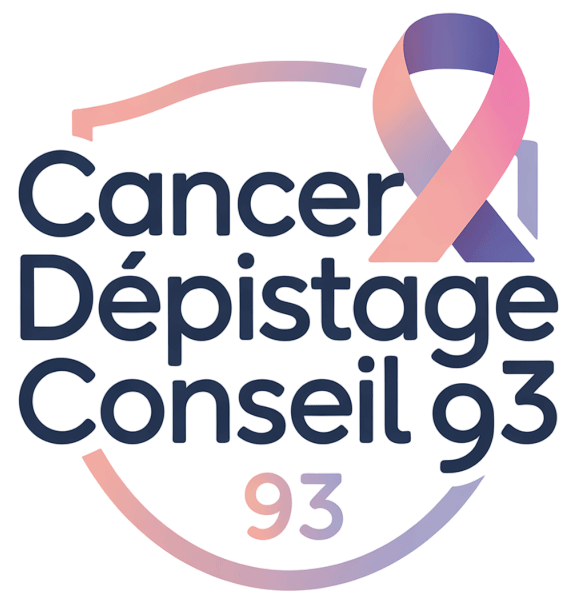Le cancer du sein est aujourd’hui le cancer le plus fréquent chez la femme en France. Près de 61 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2023, et, malgré des progrès spectaculaires dans la prise en charge et la survie, environ 12 000 femmes en meurent chaque année (Institut National du Cancer).
Pourtant, le dépistage précoce permet d’augmenter considérablement les chances de guérison. Lorsqu’il est identifié à un stade débutant, 9 femmes sur 10 survivent à leur cancer du sein dans les cinq ans qui suivent le diagnostic. Ce chiffre s’effondre lorsque la maladie est découverte tardivement. Voilà pourquoi la question de l’âge du premier dépistage – que ce soit via la mammographie ou d’autres méthodes – est cruciale.