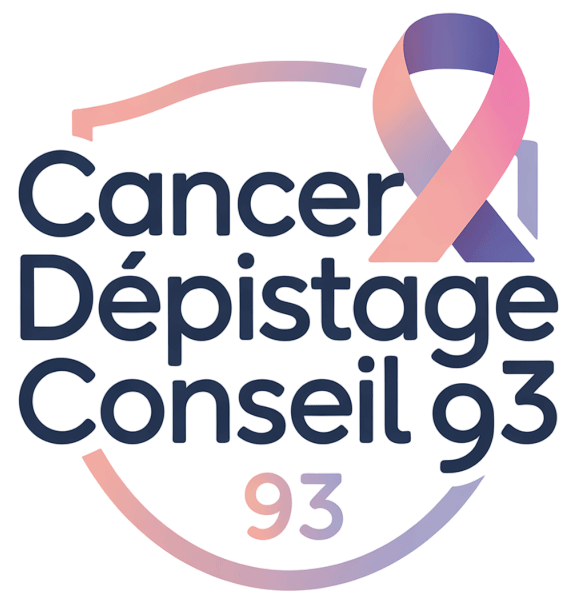Le dépistage du cancer du col de l’utérus n’est donc plus réservé aux consultations gynécologiques. En s’adaptant aux besoins de toutes, le système de santé tente de redonner du pouvoir d’agir à chacun·e. Les laboratoires et les associations de patients militent pour généraliser l’auto-prélèvement à toutes les femmes concernées, en complément des campagnes d’information menées localement.
En phase expérimentale ou déjà accessibles pour certaines, ces nouvelles méthodes donnent un nouvel élan : lever les peurs, s’approprier sa santé, et surtout rassurer. Si l’on résume, le frottis n’a plus besoin d’être source d’angoisse ni de contrainte logistique.
- Vous pouvez demander le test à votre médecin ou sage-femme sans RDV spécialisé
- Vous pouvez vous renseigner auprès de votre centre de santé, PMI ou via les campagnes de l’Assurance Maladie
- Vous pouvez, dans des cas ciblés, demander un kit d’auto-prélèvement ou bénéficier du dispositif mobile
Plus de 1 000 décès pourraient être évités chaque année en augmentant le taux de dépistage selon l’Institut National du Cancer. Pour chacun et chacune, le message est simple : il existe toujours une solution qui s’adapte à votre situation, votre pudeur, vos contraintes, et vos priorités.
La lutte contre le cancer du col de l’utérus, c’est aussi cela : avancer au rythme de chacun·e, sans stigmatiser ni culpabiliser. Et permettre, notamment dans des territoires comme la Seine-Saint-Denis, qu’aucune femme ne renonce à sa santé pour une question de distance, de peur ou d’habitude. Informer, c’est déjà protéger.
Sources : Santé Publique France ; Institut National du Cancer (INCa) ; Assurance Maladie ; HAS ; ARS Île-de-France ; Initiatives locales Seine-Saint-Denis.