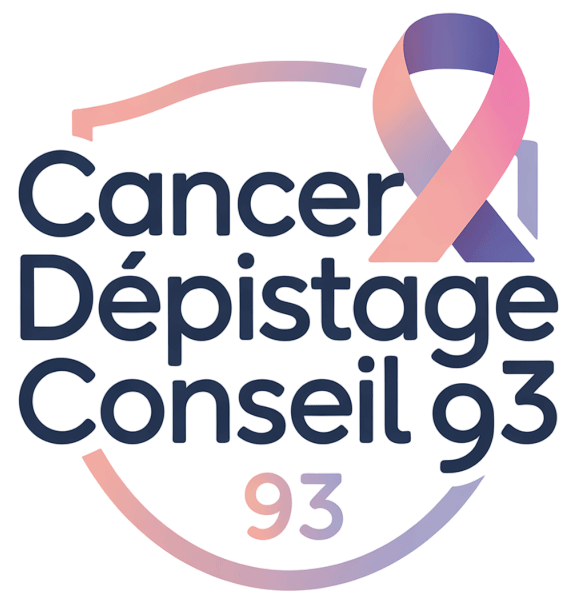Le frottis cervical, ou examen cytologique du col de l’utérus, est un des grands succès de la prévention des cancers. Il permet de repérer à un stade précoce les lésions précancéreuses induites principalement par des infections à papillomavirus humains (HPV), avant qu’elles n’évoluent vers un cancer invasif. Grâce à ce dépistage, la mortalité liée au cancer du col a chuté de près de 50% en France en 30 ans selon Santé Publique France (source).
- Chaque année, 3 000 nouveaux cas de cancer du col sont détectés en France.
- Près d’un tiers des décès surviennent chez des femmes âgées de plus de 65 ans.
- L’infection à HPV peut évoluer à bas bruit, sur plusieurs décennies.
Le dépistage est donc un outil clé, mais doit-il se poursuivre de la même manière toute la vie, ou s’arrêter à partir d’un certain âge ? Les réponses se trouvent dans l’évolution des risques et les recommandations actualisées.