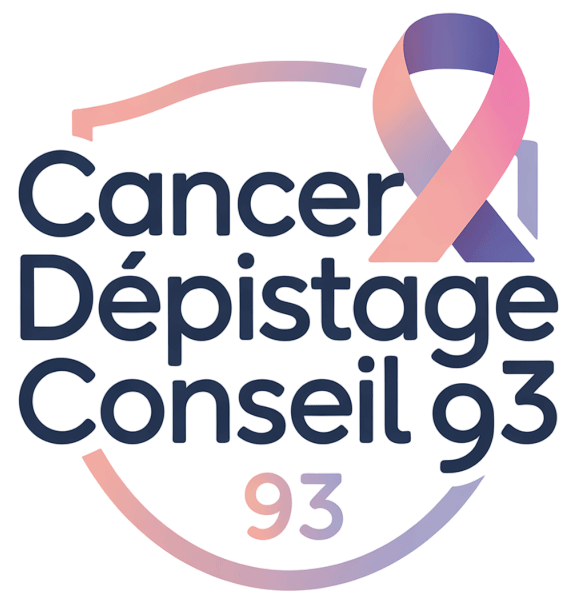En France, chaque année, plus de 160 000 femmes apprennent qu’elles sont atteintes d’un cancer. Les trois localisations les plus fréquentes chez la femme sont le sein, le côlon-rectum et le poumon (INCa). Mais d’autres cancers spécifiquement féminins, comme le cancer du col de l’utérus et celui de l’ovaire, restent des préoccupations majeures de santé publique. Voici une vue d’ensemble des principaux cancers féminins à surveiller, des signes précoces à guetter et des outils à disposition pour les dépister efficacement.
- Cancer du sein : le plus fréquent chez la femme (près de 60 000 nouveaux cas/an).
- Cancer colorectal : deuxième cancer le plus rencontré chez la femme.
- Cancer du col de l’utérus : environ 3 100 cas annuels, mais dépistage possible.
- Cancer de l’ovaire : 5 000 nouveaux cas/an.
- Cancer de l’endomètre (corps de l’utérus) : environ 8 000 cas/an en France.